star.admin.ch – une plateforme de la Confédération sur l’antibiorésistance
La résistance aux antibiotiques est un problème mondial qui touche les êtres humains, les animaux, l’agriculture et l’environnement.
Sous la loupe
One Health, une santé

StAR dans le domaine humain
Diverses directives et outils sont à la disposition des patients, des médecins et des pharmaciens afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités dans l'utilisation des antibiotiques.

StAR dans le domaine vétérinaire
En étroite collaboration avec les éleveurs de petits animaux et d'animaux de rente, les vétérinaires encouragent l'utilisation appropriée des antibiotiques et les mesures préventives.

StAR dans le domaine de l'agriculture
En bonne santé, les animaux sont vigoureux et n’ont pas besoin de médicaments. Ainsi, ils ne peuvent pas développer de résistances aux antibiotiques. Les agriculteurs et les vétérinaires sont donc appelés à promouvoir la santé animale grâce à la prévention.

StAR dans le domaine de l'environnement
L'extension des stations d'épuration permet de réduire la pollution des eaux par les antibiotiques et autres micropolluants.
Informations de base importantes

À propos de StAR
Depuis 2016, la stratégie Antibiorésistance Suisse a permis de mettre en place et d’étendre avec succès de nombreuses mesures. Le plan d'action One Health 2024 – 2027 intensifie les activités.

Utilisation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en Suisse
La surveillance des résistances et du recours aux antibiotiques chez l’être humain, les animaux de rente et de compagnie et dans l’environnement est un élément clé de la Stratégie Antibiorésistance Suisse StAR et du Plan d’action One Health 2024 – 2027.
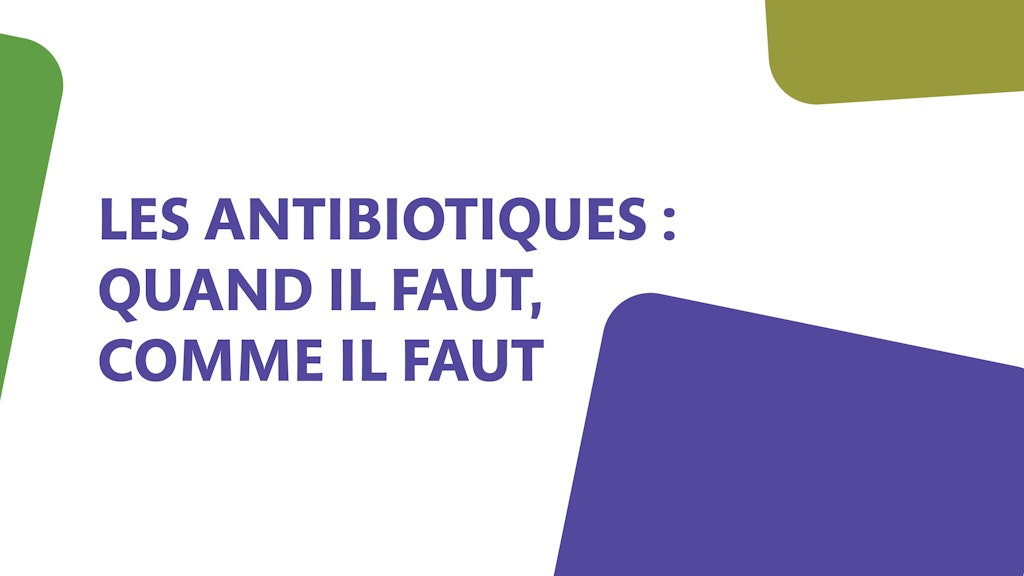
Les antibiotiques : quand il faut, comme il faut
La résistance croissante aux antibiotiques représente une menace mondiale pour les personnes et les animaux, aussi en Suisse. Pour que les antibiotiques restent efficaces, nous devons les utiliser de manière responsable.


